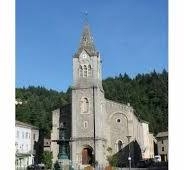Tout le monde a vu un clocher ; c'est même un édifice emblématique des villes et villages de France, puisqu'on en trouve dans chaque localité (parfois plusieurs) grande ou petite, il est tellement commun qu'on l'oublie parfois. Pourtant tous ne sont pas identiques, loin de là : Leur aspect peut changer selon l'époque de construction, la région d'implantation, voire l'habileté des bâtisseurs. On s'aperçoit de ces différences pour peu qu'on soit attentif. Mais avant de les observer de plus près, il convient de se poser la question : Qu'est-ce qu'un clocher ?
1.Par définition, un clocher est un édifice contenant des cloches . Celles-ci sonnent les heures, mais aussi les manifestations religieuses : messes, baptêmes, mariages, obsèques (glas) autrefois les événements graves tels que guerres, incendies (tocsin) et le rythme des journées des paysans (angélus). Certaines de ces fonctions ont aujourd'hui été abandonnées en raison de changements de mode, de vie ou de progrès technologiques, mais il n'empêche, le clocher, de par son emplacement (imbriqué dans l'église) et sa fonction demeure étroitement lié à la religion catholique, même si le lien s'est aujourd'hui distendu.
2.Comment se présente un clocher ?
Un clocher est généralement formé de deux parties
- La partie inférieure est la tour, bâtie au dessus du porche de l'église, en pierre, parfois en brique. Elle peut être de hauteur variable et c'est elle qui contient les cloches, dont le son peut s'échapper vers l'extérieur grâce à des orifices latéraux, parfois munis de volets.
Eglise du Cheylard :
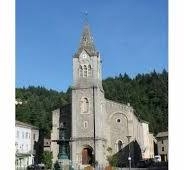
- La partie supérieure est le toit ( couvert en tuiles ou en ardoises) qui coiffe l'édifice, permet l'écoulement des eaux pluviales à l'écart de la terre et assure la protection des cloches et de leur mécanisme. Le toit est souvent surmonté d'une croix (religion oblige).
Il faut remarquer que certains clochers se réduisent à un pan dressé à la verticale au dessus du porche de l'église, percé d'orifices où sont logées les cloches, à l'air libre. Ces clochers particuliers sont appelés clochers-peigne.
Eglise de Saint-Front :

3.Typologie des tours : Le pus souvent, une tour de clocher est de section carrée, mais elle peut aussi être au dessus du porche de l'église, plus rarement, de section hexagonale, octogonale, voire cylindrique. Certaines tours, au lieu d'être bâties sont simplement accolées à celle ci, et même parfois complètement séparées.
Abbatiale Sainte Marie, Cruas :

Église de Saint Julien d'Intres :

B. Typologie des toits : Comme les tours ils peuvent être de formes variées,
pyramidales (à quatre, six, huit pans) coniques, en bulbe, en dôme. Les toits en forme pyramidales peuvent être quasiment plats (faible inclinaison des pans) mais aussi très effilés ou élancés, dans ces cas là on parle de flèches. Ils peuvent être colorés, décorés (tuiles vernissées).
Basilique St Jean François Régis Lalouvesc :

Les clochers, outre le fait de contenir les cloches, sont parfois équipés de cadrans solaires (utiles à une époque où les pendules d'extérieur et les montres individuelles étaient rares.)
Enfin, il faut remarquer qu'avant l'électrification, les clochers étaient actionnés à la force des bras, à l'aide de cordes, par une personne désignée à cet effet : Le sonneur.
Les clochers des Boutières : Les clochers-peignes n'étaient pas une simple fantaisie architecturale ou caprice des bâtisseurs. Ils avaient une utilité pratique. A l'époque pas si lointaine (qui a duré dans nos campagnes jusque dans les années 1920/1930) où l'électricité était inconnue, les routes mal aménagées, la signalétique inexistante et où l'on se déplaçait souvent à pied, les cloches, battant librement au vent, permettaient au voyageur égaré dans la tempête (la bûrle) de se guider vers les villages proches.
Clocher de saint-Martin-de-Valamas :

Gilbert Verdier