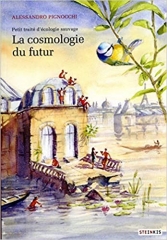En réaction au billet « Des hommes, des idées et des pierres » paru dans le numéro d'avril, un commentaire signé par un conseiller municipal a attiré l'attention de quelques lecteurs qui m'ont fait part de leur étonnement. Je me permet donc ici de répondre plus précisément que je ne l'ai fait dans la rubrique « commentaires ».
Je pensais que le travail des employés municipaux méritait d'être remarqué et honoré. Peu avant d'écrire mon billet, une information avait attiré mon attention : Le candidat Emanuel Macron annonçait que dans son programme les enseignants seraient payés en fonction de leurs prestations. Imprudemment, pensant que ma tendance à employer le second degré était de notoriété publique, j'ai cru bon d'incorporer cette information à l'hommage que je voulais rendre aux hommes de l'art en suggérant que « peut-être il en soit de même pour ces employés municipaux. ». Je pensais même que ce billet était plutôt positif par rapport à l'action de la commune.
A voir la virulence du commentaire faisant suite à ce billet, J'ai peur d'avoir lancé un pavé (de la Calade de la Mairie) dans la mare (du conseil municipal).
Oui, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Qu'il me soit permis de faire remarquer que chaque habitant, par ses impôts, contribue indirectement à rémunérer les employés municipaux, nous sommes donc tous un peu "payeurs".
Mais voilà, comment un modeste citoyen aurait-il l'audace de donner un conseil à des gens qui ont justement été élus pour leurs compétences ?
Non, il ne s'agissait pas d'un conseil mais d'une suggestion destinée à rappeler à la municipalité quelle chance est la notre d'avoir de tels professionnels qui nous épargnent d'employer des entreprises privées pour ces travaux d'embellissement du village.
Bien sûr, comme le suggère finement l'auteur du commentaire : Voulant me mêler d'affaires relevant du domaine public, j'aurais dû « monter une liste, me présenter aux élections municipales, législatives, départementales, etc. » Mais voilà, pour cela il faut se sentir capable de représenter les citoyens dans leur ensemble. Je n'ai pas cette prétention. Cela m'empêche t-il de donner mon avis ? Un avis, simplement un avis, pas un conseil. Le citoyen lambda, électeur, n'a t-il le droit que de voter et ensuite se taire ?
Une place sera réservée dans le prochain numéro au conseiller municipal en question pour un droit de réponse, à moins qu'il préfère que l'on règle ça autour d'un verre de Bourgogne.
François Champelovier