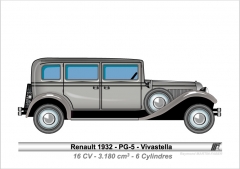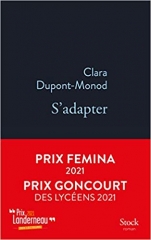Si le préfet de l’Ardèche se déplaçait beaucoup dans le département, notamment pour les tournées de révision, il n’était pas un touriste ni un voyageur mais utilisait une voiture de tourisme…
Lors de la première session du Conseil général de 1922, le Préfet déclarait : « La voiture remise au département par le ravitaillement était en mauvais état et avait, l'an dernier, nécessité de grosses réparations ; elle était, en outre, très dispendieuse. J'ai pu néanmoins, ne pouvant m'en débarrasser à un prix convenable, m'en servir pour les multiples déplacements qui me sont imposés pour répondre au désir des municipalités ou des comités et elle a pu faire la tournée de révision dans tout le département, sans de trop graves incidents. A la fin de la tournée de révision, la voiture est restée sur la route et elle a dû être remorquée à Privas où elle est inutilisable sans des réparations qui coûteraient plus qu'elle ne vaut ».
Un préfet qui tombe en panne sur les routes d’Ardèche, ce n’est pas banal. Il s’agissait de Jules Paul Auguste Fuster qui avait pris ses fonctions de préfet de l’Ardèche en août 1921, après avoir été sous-préfet de Largentière et de Tournon. Lors de cette session, il proposait l’achat d’une voiture de remplacement « de très bonne marque, entièrement remise à neuf » dont le coût était de 20.000 francs. L’année suivante le Conseil votait un crédit pour assurer la voiture du Préfet et son chauffeur.
Des contestations et accusations politiques commençaient a s’exprimer en septembre 1924. Un conseiller générale qui ne voulait pas s’associer à des félicitations au Préfet déclarait : « J'avais une certaine conception sur l'usage de l'auto préfectorale : je ne pensais pas qu'elle pût servir à faire de la pression électorale. Autant : je considère les dépenses d'essence utiles lorsqu'il s'agit de faciliter l'administration en se rendant dans diverses communes, autant je les estime condamnables lorsqu'elles servent, comme nous l'avons vu, à un fonctionnaire pour mener campagne contre le Cartel des Gauches(1) ». Le rapport de cette séance précise : « Les interpellations se croisent, l'assemblée devient houleuse et M. le Président lève la séance » qui sera suspendue pendant dix minutes.
Le double jeu des préfets était signalé depuis longtemps. Dans un ouvrage publié en 1869, Charles de Lacombe (2) écrivait « Qu'il soit dans ces promenades administratives fort question des candidats, c'est ce qui ne fait doute pour personne. La chose est illégale ; les conseils de révision ne sont pas des réunions politiques; mais nous n'en sommes plus, comme le disait M. Thiers, à compter les illégalités ». Les tournées de révisions permettaient aussi une rencontre avec les maires et une enquête discrète sur le territoire.
Un an plus tard le préfet Regnaut demandait une rallonge de son crédit, « en raison du coût de plus en plus élevé des dépenses d'entretien et de réparations » et présentait la même demande l’année suivante.
En 1928 la voiture est jugée comme un « modèle très ancien et fort usagée » et ayant absolument besoin d'une révision complète qui s’imposait puisque l’on était « à la veille de la prochaine tournée des conseils de révision ». Trouvant les réparations trop onéreuses par rapport à la valeur de la voiture le préfet Regnaut proposa l’achat « d'une automobile neuve Renault, conduite, intérieure, 7 places, cotée 32.000 frs » en précisant que le département « réaliserait sur la Delaunay Belleville » dont il disposait « une économie certaine d'environ 50 %, tant sur l'achat des pneumatiques, que sur la consommation d'essence (12 à 13 litres au lieu de 25 au 100 km.)... ». On peut noter que la consommation d’une actuelle Lamborghini Aventador SV est annoncée, par le constructeur, à 10,7 l/100 km en trajet extra-urbain et 24,7 l/100 km pour un trajet urbain et il n’y a que deux places. Le Préfet ayant observé que « dans la plupart des départements une indemnité est allouée au chauffeur de l'automobile préfectorale » demanda et obtint un crédit spécial « pour indemnité au chauffeur de l'automobile préfectorale ». C’était un garçon de bureau qui était alors chargé de la conduite de la voiture…
En avril 1929, lors de la première session du Conseil général, il est rapporté que la voiture mise à la disposition du préfet Angello Chiappe était dangereuse : « carrossée pour transporter sept personnes, sur un châssis établi pour une voiture à cinq places, est d'une instabilité qui peut être dangereuse pour ses occupants, surtout sur les voies de communication du département qui comportent de nombreux tournants à faible rayon ». Après divers arrangements et tractations la voiture a été échangée, par l’intermédiaire d’un garagiste de Privas, représentant de la maison Renault, contre une nouvelle, de même force, 10 CV, datant de l'année 1928 et ayant cinq places. Un changement est intervenu lors de la réunion du 12 juillet. La Commission départementale proposa l’achat d’une voiture automobile 11 CV Renault, conduite intérieure, luxe, 7 places, 32.800 Fr. franco à Privas.
En octobre 1931 la commission des finances réévaluait le salaire « du jardinier de la Préfecture qui a été chargé, depuis le 1er juin 1929, en même temps, de la conduite et de l'entretien de l'automobile mise à la disposition du département ». Elle annonçait : « la voiture préfectorale nécessite des réparations importantes pouvant grever lourdement le budget, sans que la voiture présente pour l'avenir, les conditions de confort et sécurité souhaitables ». Un crédit de 20.000 francs fut voté. Au début de l’année 1933 le conseil validait la commande d’une voiture automobile neuve pour le préfet Henry Piton, une 16 CV Vivastella fournie par la Société Anonyme des Usines Renault qui s’engageait à reprendre l’ancienne voiture.
En 1935 il faut procéder « à des réparations importantes à la voiture automobile de la Préfecture et spécialement à la révision du moteur, dont l'usure commence à se manifester » et il est envisagé de changer la voiture. Tous les garagistes de privas ont été sollicités pour avoir des propositions, mais c’est la soumission des garagistes Dache et Pic de Valence qui a eu un avis favorable l’année suivante. Ils s’engageaient à livrer une voiture Hotchkiss, type 486, carrosserie Vichy, moyennant la reprise de l'ancienne voiture et le versement d'une somme de 25.000 francs
En 1938 le préfet André Jean-Faure signalait qu’il possédait une voiture automobile dont il se servait habituellement au lieu d'utiliser celle du département et demandait qu’elle soit assurée avec le contrat de la voiture préfectorale. Ce qui fut accepté. L’année suivante le Préfet précisait que depuis un an sa voiture avait totalisé, en Ardèche, plus de 13.000 kilomètres, ce qui, par voie de conséquence, réalisait une économie de circulation importante pour la voiture du Département ». Il demandait que « les menues réparations nécessitées par l'usage courant de sa voiture personnelle » soient comptées sur le crédit régulier de réparations de la voiture préfectorale. Jusqu’en 1940 les frais d’assurance, d’entretien et de réparation de la voiture personnelle du Préfet ont été à la charge du Département.
Les Conseils généraux sont suspendus par le gouvernement de Vichy et rétablis à la Libération. A partir de 1982 ils ne sont plus sous la tutelle d’un préfet et acquièrent un pouvoir exécutif. Je n’ai pas d’informations sur la voiture de l’actuel Préfet. Savoir quelle est la voiture du Préfet peut préoccuper certains petits français : une trentaine d’élèves d'une école de Châteauroux visitaient en mars 2017 la préfecture et rencontraient le préfet du département. Parmi les questions sur sa voiture : « Vous avez une limousine ou une voiture normale ? » « Une grosse voiture ? » « Y a-t-il un écran dans votre voiture ? » (Extrait d’un article du site web du journal La Nouvelle république).
Il y longtemps que je n’ai pas rencontré le chauffeur du Préfet… vivement qu’il y ait de belles et grandes inaugurations officielles… pour que je puisse lui poser des questions sur les véhicules officiels de la préfecture.
Notes
1 - Le Cartel des gauches est une coalition électorale, constituée dans une cinquantaine de départements, pour les élections législatives de 1924 entre les radicaux indépendants, le Parti radical et radical-socialiste, le Parti républicain-socialiste auquel se joignirent des socialistes indépendants, et la SFIO. Cette coalition a été formée contre la majorité de droite du Bloc national (les blocards). C’est un pur hasard si le Cartel des gauches et le Bloc national sont évoqués en cette période électorale.
2 - Journaliste, député et historien (1832-1904), dans Les Préfets et les maires. Les préfets en tournée de revision (sans accents, voir prochain épisode).
alorsLa Delaunay Belleville révisée en 1922 pouvait être un modèle de ce style. La Société Anonyme des Automobiles Delaunay Belleville est créée vers 1905. Plusieurs modèles furent choisis par les « grands de ce monde » ; le Tsar Nicolas II de Russie en posséda plusieurs. La société continua à produire jusqu'en 1948-1951 des voitures de grande qualité en nombre de plus en plus restreint, la diversification de ses activités lui permettant de subsister.

Une Renault Type PG-5 Vivastella de 16 CV. C’est une automobile fabriquée par Renault de 1929 à 1939 qui a fait son entrée sur le marché des voitures de luxe. Elle est « richement dotée d'une ambiance cosy avec son habitacle tendu de velours soyeux ». Vitesse 110 km/h. (https://renaultheque.wordpress.com/).
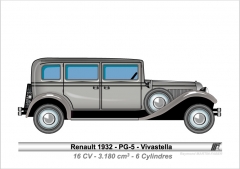
Hotchkiss Vichy. Elles sont caractérisées par les trois vitres latérales. Conduite intérieure, 4 portes, 6 glaces, 7 places dont deux strapontins dos aux portières, grand coffre. Fabrication : 1929 à 1939. Crée en 1855 par l’américain Benjamin Hotchkiss à Rodez, pour d’abord construire de l’armement, la marque produit des automobiles de 1904 à 1954.

Jean-Claude Ribeyre