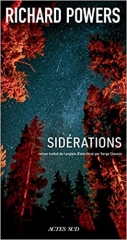-
CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE
Saint-Martial est une commune très étendue, avec une superficie de 36,18 km2.Dans sa plus grande longueur, elle mesure 8,4 km, et sa plus grande largeur est au maximum de 6 km (à l'ouest). Elle s'étire selon une direction approximative ouest/est.
L'altitude varie de 674 m (à l'aval du confluent Eysse/Escoutay) à 1551 m au Gerbier de Jonc, le dénivelé étant donc de 877 m, ce qui en fait une commune fort contrastée au point de vue climatique. On peut donc estimer l'altitude moyenne autour de 1150 m. La commune est d'ailleurs essentiellement montagnarde, la majeure partie du territoire se situant au-dessus de 1000 m (notamment à l'ouest, avec divers sommets au-dessus de 1500 m, notamment le Gerbier de Jonc et le suc de Sara à 1521m).
Le volcanisme marque fortement la commune, avec de nombreux pics dus à celui-ci, surtout à l'ouest (Gerbier, Sara...) et des maars (plaine de Saint Martial).
La commune est traversée par trois cours d'eau principaux: l'Eysse et ses affluents du ruisseau du Pradal et l'l'Escoutay, tous issus du relief volcanique de l'ouest.
Le territoire est très largement boisé, notamment à l'ouest (l'immense forêt domaniale de Bonnefoy), avec de grandes étendues de conifères, mais aussi des hêtres et des châtaigniers.
-
L'HABITAT
Au cours des siècles, la population de Saint-Martial s'est installée dansde très nombreux hameaux, souvent situés le long des vallées, généralement sur le versant adret. Citons, parmi les plus importants , Condas, Chevalier, la Chazotte, Besse, le Pradal...quasiment tous à une attitude inférieure à 1000 m (1). Par contre, le bourg-centre, lui, est à l'écart de tout cours d'eau. Installé à flanc de colline, à l'altitude de 870 m, il s'étire dur une longueur de plus de 1 km, face à l'est, bénéficiant d'un très bon ensoleillement et relativement protégé des vents d'ouest et du nord. De plus le village domine un ancien maar (aujourd'hui un lac artificiel), avec des champs fertiles s'étendant sur sur ses pentes et pourvu de nombreuses sources. On comprend mieux ainsi la prospérité du village au cours des siècles passés.
L'habitat est caractéristique des régions volcaniques: constructions en basalte avec souvent des toits de lauze. Bien sûr, cet habitat était essentiellement agricole, sauf au bourg, où s'étaient implantés divers commerces et services.
-
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE SAINT-MARTIAL:
La population de Saint-Martial a suivi la même évolution que celle de l'ensemble des Boutières au cours des deux derniers siècles: expansion, avec une forte densité au XIX° siècle, puis dégradation très marquée au XX°, jusqu'à nos jours. Saint-Martial, à l'instar de sa voisine Borée, a connu son apogée démographique en 1851 (2130 habitants). Elle était alors la commune la plus peuplée des Hautes Boutières, à l'exception du Cheylard, mais devant Saint-Martin de Valamas (2107) et Borée (2052), avec une densité de 59 hab/km2 ! (Saint-Martin aujourd'hui: 56 hab/km2).
La situation n'a cessé de se dégrader depuis, assez lentement d'abord (en 1911, la commune n'avait perdu que 600 habitants en 60 ans), puis plus rapidement ensuite, au cours du XX° siècle. Aujourd'hui, la commune de Saint-Martial ne regroupe plus que 250 habitants environ, pour une densité de 6,8 habitants au km2. En 170 ans, la population de Saint-Martial a été divisée par 8,7.
-
C'est là une différence importante avec Borée: à Saint-Martial, la population se groupe entre 700 et 1000 m , alors qu'à Borée, elle se situe au-delà de 1000m.
Gilbert Verdier